Skip to content




Case studies
- Pages

 Quand la nature devient un actif stratégique
Quand la nature devient un actif stratégique
Cet été, beaucoup d’entre nous se (re)connectent à la nature – en marchant, en respirant, en ralentissant – il est temps de prolonger cette sensation et de l’intégrer, doucement mais sûrement, dans nos façons d’agir en tant qu’entreprises.
Dans le cadre de notre thématique annuelle autour du CARE, France Lemmens est allée à la rencontre de Corinne Boulangier, marraine engagée du thème, pour parler de conscience, de gouvernance, et de ces outils concrets qui permettent d’avancer vers une économie plus vivante.
Voici leur échange, en toute simplicité, au rythme d’une conversation vivante et inspirante.


Être marraine de la thématique 2025 de La SMALA #CARE
F.L. : La mission de la SMALA est d’accompagner les dirigeants d’entreprises dans leur réflexion stratégique et de déployer des stratégies d’impact innovantes et authentiques. La SMALA croit fermement que les entreprises ont un rôle à jouer pour construire un monde plus durable.
Connaissiez-vous la SMALA et que pensez-vous de ses missions ?
C.B. : Je ne connaissais pas la SMALA avant d’être contactée pour être marraine du thème annuel du CARE mais j’ai tout de suite été réceptive au message qu’elle véhicule, essayant moi-même de mobiliser mes compétences pour ce secteur de la transition des organisations.
Nous avons des visions très similaires dans notre approche de la transition de l’économie et j’ai été bluffée par cette organisation très qualitative en termes d’exigence, d’information et des processus mis sur pied ; avec la SMALA, on constate très vite que la démarche est réfléchie et nourrie de contenus scientifiques.
F.L. : Que souhaitez-vous apporter en tant que marraine ?
C.B. : Au fur et à mesure de mes expériences au sein de la RTBF, et de sa nécessaire évolution liée notamment à la transformation digitale des médias, j’ai eu l’occasion de devenir manager de l’innovation, une fonction transversale en lien avec la transformation stratégique de l’entreprise et la construction de son écosystème. Une expérience que je cherche à partager aujourd’hui pour aider les PMEs à innover et faciliter leur transition”.
Quand une entreprise doit innover, c’est parce qu’elle a conscience qu’elle doit « se transformer », « changer » ou « évoluer ». Le management de l’innovation, c’est un management de la créativité au service de la transformation, guidé par des processus structurés. Sans processus, il est difficile de créer de la valeur et d’aboutir à du résultat concret.
F.L. : Avez-vous déjà participé à une organisation telle que la SMALA, en tant que membre ou marraine ?
C.B. : Ces 10 dernières années je me suis beaucoup investie dans les communautés de pratiques et d’intérêt liées au développement de l’industrie culturelle et créative et des médias. Il y a dans ces dynamiques sectorielles une dimension de développement de ressources, de savoirs et de compétences, dont la transition a aussi besoin. La transition a besoin d’écosystèmes qui créent de nouvelles chaines de valeur.
L’erreur serait d’imaginer des solutions à un problème sans comprendre le problème: s’informer et créer du SAVOIR sont donc essentiels.
LE CARE en entreprise
F.L. : Le CARE (pour « Comprehensive Accounting In Respect of Ecology »), c’est un concept encore à l’étude qui envisage une comptabilité à 3 piliers : financier, écologique et humain. Si vous étiez ministre de l’Environnement, avec un vrai pouvoir de décision, qu’est-ce-que vous mettriez en place pour que ce modèle devienne plus structurel ?
C.B. : Je pense à 2 points :
1- Le premier c’est de reconnaitre que l’impact environnemental représente un enjeu urgent. Ce qui m’interpelle aujourd’hui, c’est le manque de conscience à ce sujet, voire le recul que l’on observe dans certains discours ou décisions, alors que l’urgence climatique et l’effondrement de la biodiversité s’accélèrent.
"Et si la vraie question n’était plus : comment pouvons-nus prendre soin de la planète?
Mais bien : Quel impact la planète a-t-elle désormais sur notre business ?"
Or, les organisations engagées dans une démarche de transition réalisent progressivement que le changement climatique peut avoir des répercussions directes sur leur propre chaîne de valeur. Ignorer cet enjeu, c’est prendre le risque de subir demain des perturbations majeures sur ses activités.
Le coût de l’inaction est documenté, et il existe aujourd’hui des outils concrets qui permettent d’identifier à chaque maillon de sa chaine de valeur les impacts potentiels des aléas climatiques. Ces outils rendent visibles les vulnérabilités et ouvrent des pistes d’action. C’est à la fois accessible, opérationnel et essentiel pour anticiper.
2- La deuxième chose, c’est que même lorsqu’une entreprise est volontaire dans sa démarche de transformation, il faut rester lucide : c’est un chemin complexe. Il est donc nécessaire de mettre en place des mécanismes de soutien – des incitants fiscaux, par exemple – et, dans certains cas, de recourir à des obligations, voire à des sanctions. Car au fond, c’est l’intérêt collectif qui est en jeu.
On construit la richesse économique à partir de ce que la planète offre – sols, matières, énergie – et de ce que les humains apportent – leur temps, leur force, leur intelligence. Pourtant, ni la planète ni les personnes ne sont des ressources infinies. C’est pourquoi il est urgent de repenser nos modèles économiques. Tant que les coûts environnementaux et sociaux restent invisibles dans la comptabilité, les entreprises continueront à maximiser leurs profits tout en externalisant les dommages. Le résultat ? Des bénéfices concentrés entre quelques mains, pendant que les pertes – pollution, épuisement des ressources, mal-être au travail – sont partagées par tous.
Il faut opérer un changement de paradigme. Chaque organisation devrait être capable d’évaluer non seulement ses résultats financiers, mais aussi son impact global, y compris les "coûts cachés" qu’elle génère pour la société et pour les générations futures.
F.L. : Que pensez-vous des obligations de reporting extra-financier imposées par la directive CSRD, telles qu’adaptées dans la loi européenne Omnibus – notamment après leur allègement récent ?
(C.B.) : L’application de la directive CSRD était d’une complexité indéniable, et le bien-fondé conceptuel de la mesure de la double matérialité a été perdu de vue, noyé sous la lourdeur administrative. Les détracteurs de la transition se sont servis de cette lourdeur de l’outil pour tuer la démarche, qui est pourtant indispensable parce que c’est l’habitabilité de notre planète qui est en jeu. Peut-être aurait-il été pertinent d’implémenter l’objectif de double matérialité avec plus de souplesse et d’agilité – comme en gestion de l’innovation, ne pas déployer tout le projet d’entrée de jeu, y aller par étapes successives en commençant par le cœur de proposition de valeur. J’observe en tout cas que les org anisations qui veulent avoir de l’impact, poursuivent dans cette mesure de leur double matérialité, sans vouloir tout couvrir mais en commençant par sélectionner quelques indicateurs clés sur lesquels elles concentrent leurs efforts.
F.L. : L’Europe a un vrai rôle à jouer ; or, on constate un recul généralisé, qu’en pensez-vous?
C.B. : Ce recul est un non-sens. Il y aurait une position géopolitique à construire pour l‘Europe, comme elle a tenté de le faire dans la transition numérique avec par exemple le RGPD. La durabilité peut être perçue comme une entrave à court terme, mais elle représente au contraire un levier stratégique sur le long terme. La Chine prend cette position motrice ; elle s’est alignée sur la double matérialité, elle effectue des investissements records dans l’économie de la transition. Le backslash écologique à l’œuvre en Europe me semble absurde, en termes de souveraineté et de position géopolitique.
F.L. : Le CARE dans sa dimension sociale et humaine a également une importance fondamentale pour vous ; le CARE sous-tend la recherche d’un sens dans son travail, qui est un critère devenu fondamental, notamment pour les jeunes générations.
CB. : Oui, cest une réalité de plus en plus visible. L’engagement d’une organisation dans la transition – en particulier environnementale – répond à un besoin profond de sens chez les employés. Beaucoup ne supportent plus de consacrer leur énergie à une entreprise qui ne contribue pas, d’une manière ou d’une autre, à faire face à l’urgence climatique. Ils ont besoin de CARE : pour eux-mêmes, pour les autres, et pour leur environnement. Dans une société marquée par l’épuisement généralisé, cette attente devient un critère fondamental d’engagement et de fidélité. C’est une dimension que les organisations ne peuvent plus ignorer.
F.L. : Quel conseil donneriez-vous à un dirigeant d’entreprise qui veut avoir un maximum d’impact sur son environnement ?
C.B. : Il s’agit d’identifier là où son entreprise a, de manière spécifique, un réel pouvoir d’action. Cela demande de prendre un peu de recul, de s’informer, et de réfléchir à sa propre identité : qui suis-je, quelle est ma réalité, et où puis-je avoir l’impact le plus juste ? L’enjeu, c’est de concentrer son énergie là où elle fera vraiment la différence.
Comment une PME peut prendre soin de la Nature?
F.L. vous avez dernièrement choisi de développer des services pour apporter de l’expertise et de la connaissance pour permettre aux conseils d’administration donner une voix à la Nature dans leur prise de décision ; pouvez-vous nous en dire plus ?
C.B. : Oui, c’est encore en phase d’expérimentation. Mais l’idée est simple : si on veut développer une activité sans être uniquement guidé par des logiques financières, il faut reconnaître que la nature et l’environnement sont aussi des parties prenantes à part entière. La proposition, c’est donc de leur donner une place dans les organes de gouvernance de l’entreprise.
Concrètement, il ne s’agit pas de représenter "la nature" au sens large – ce serait trop vaste – mais d’identifier, pour chaque entreprise, l’entité naturelle qui est la plus pertinente, voire la plus stratégique dans son modèle. Cette entité est alors considérée comme un actif de l’entreprise (ou plutôt comme un passif, parce que nous avons une dette envers la Nature), au même titre que ses collaborateurs, ses finances ou son savoir-faire. Et l’enjeu, c’est de la représenter concrètement au conseil d’administration ou à un organe de décision.
Nous sommes quelques-uns, en Belgique et à l’international, à proposer des dispositifs de gouvernance avec la nature. Ce sont des modes opératoires dans lesquels je crois, parce qu’ils proposent des cadres qui permettent de connecter concrètement la nature avec la réalité de chaque organisation.
Je propose cela aujourd’hui en m’appuyant sur mon parcours qui m’a permis de vivre de l’intérieur des situations de transformation : en tant que dirigeante, administratrice, ou encore dans des contextes de crise. J’ai appris à prendre du recul, à structurer la réflexion stratégique plus qu’à intervenir dans l’opérationnel. Et j’ai à cœur de rendre les choses complexes accessibles, en m’appuyant sur un langage clair et sur les bonnes personnes pour identifier les indicateurs et leviers pertinents.
En pratique, je m’appuie sur des outils de gestion, comme la comptabilité écologique, et sur des pools d’experts pertinents pour chaque entité naturelle, qui ont la connaissance permettant de comprendre les enjeux écosystémiques complexes dont elle relève. Mon rôle est de connecter cette réalité naturelle aux process de l’organisation, de la rendre compréhensible et de la prendre en compte dans les décisions.
La promesse pour l’entreprise, notamment pour une PME, c’est de renforcer sa pérennité en intégrant de manière cohérente et stratégique l’environnement dans sa gouvernance. C’est une nouvelle forme d’intelligence collective, qui ouvre des perspectives concrètes de résilience.
F.L. : Vous pouvez donner quelques exemples ?
C.B. : Je vais en donner deux :
- la chapelle musicale Reine Elisabeth à Bruxelles : Le CEO souhaite développer l’impact sociétal de l’organisation. Il développe donc une politique d’inclusion, qui vise à partager l’excellence musicale et la rendre accessible au plus grand nombre, et il a fait appel à moi pour définir une stratégie d’impact environnemental. Nous sommes au début du processus, que nous avons structuré sur trois axes de travail. Nous avons lancé un axe de travail sur la décarbonation de l’organisation. Ensuite nous développons un axe d’impact sur la biodiversité ; nous avons identifié que l’entité naturelle parlante pour la Chapelle était le parc paysager qui l’entoure, nous nous employons à mesurer le bon état écologique de ce parc et à mettre en place une démarche de régénération. Et enfin nous avons identifié que la Chapelle et le parc naturel qui l’entourent, sont des vecteurs de re-sensibilisation à la nature, ce qui est un des enjeux de la transition. Nous développons donc des activités mêlant excellence musicale et nature. Bref, en observant l’organisation Chapelle avec des lunettes « environnement », nous avons défini là où elle pèse sur cet environnement et où il est nécessaire d’amener de mesures correctrices, et là où l’organisation peut mener de nouvelles actions, pertinentes pour elle et bénéfiques pour la nature.
- J’ai collaboré aussi avec des entreprises riveraines d’une rivière, qui souhaitaient améliorer leur impact sociétal et environnemental. Là aussi nous avons pu définir des actions nouvelles d’impact environnemental, en observant l’organisation « avec les yeux de la rivière » grâce à un pool d’experts qui ont pu révéler des enjeux non adressés de cette rivière, mais aussi des opportunités qu’elle représente et qui étaient non saisies parce que non connues. Ecouter la rivière a permis d’agir.
F.L. : Ces considérations rejoignent également la question de doter certaines entités naturelles de la personnalité juridique et ce, pour sortir d’une vision très humano-centrée et aller vers une vision plus écosystémique. Vous en pensez quoi ?
C.B. : On a donné à des choses qui n’existent pas, à des entreprises, une personnalité juridique alors que des entités naturelles, très existantes pour le coup, en sont dépourvues… Il y a une invisibilisation complète d’une partie prenante indispensable. Mais il y a beaucoup de créativité sur ce sujet actuellement. C’est le fleuve Whanganui en Nouvelle-Zélande qui a été le premier à avoir une personnalité juridique et ce sont directement les habitants du fleuve, qui en sont dépendants, qui ont été à l’initiative de cette démarche et ils en sont le porte-voix.
La cour interaméricaine des droits de l’homme a officiellement reconnu cet été que la nature a des droits, et que le respect de ces droits est lié au respect des droits humains. C’est une évolution significative dans la reconnaissance de l’interconnexion de l’ensemble du vivant – humain et non humain. Ce sujet des droits de la nature est un champ de réflexion qui bouge et qui est passionnant.


Qui est Corinne Boulangier ?
F.L. : Au vu de ce que j’ai pu lire sur vous, puis-je résumer en disant que vous êtes une littéraire, journaliste, amoureuse de la nature, femme de culture, qui aime les défis, intuitive et qui a du mal à dire non ?
C.B. : (elle rigole concernant le dernier point) tout est juste mais il y a une nuance, c’est que je ne suis pas journaliste ; j’ai suivi des études de philologie romane puis des études de théâtre à l’IAD mais je n’ai pas ma carte de journaliste ; j’ai bossé dans les médias et j’ai été productrice de contenus (animatrice en radio et en télé). Mon rêve était de faire du théâtre, mais quand je me suis lancée, j’ai été déçue de certains mentalités dans ce milieu. Finalement, le hasard a bien fait les choses ; j’ai rencontré les bonnes personnes à la RTBF et j’ai eu des opportunités très intéressantes.
F.L. : Si je vous montrais une photo de vous petite, vous diriez quoi à cette petite fille ?
C.B. : Je lui dirais que ça va aller et que la vie, le hasard mettent sur la route des opportunités au bon moment et qu’il faut savoir les saisir.
F.L. : Vu toutes les étapes professionnelles que vous avez déjà vécues, on se doute que vous êtes une femme très volontaire et déterminée ; qu’est-ce qui vous aide à vous fixer des objectifs et à vous y tenir ?
C.B. : Moi, je suis un lanceur ; j’aime bien défricher, lancer des idées, des initiatives, donner l’impulsion. Et franchement, plusieurs personnes m’ont donné confiance dans mon ‘good feeling’, dans mes intuitions et dans ma capacité à les réaliser. Ça a été extrêmement porteur pour moi.
F.L. : On parle du CARE, comment prenez-vous soin de vous ?
C.B. : La meilleure façon de prendre soin de moi, c’est de pouvoir rapidement m’immerger dans la nature ou tout simplement dans mon jardin et mettre mes mains dans la terre, dans mon potager. Le fait que la nature ressource, ce n’est pas qu’une vue de l’esprit, c’est physiologique, ça a vraiment des impacts sur tous les sens.
F.L. : Vos grands-parents étaient agriculteurs ; ça vous a donné l’amour de la terre très jeune ?
C.B : Oui, j’ai été élevée entourée d’animaux, au rythme des saisons, la nature était omniprésente, je savais que les fish-sticks ne naissaient pas dans des boîtes 😉 Après, mes grands-parents, comme beaucoup d’agriculteurs de cette époque, n’étaient pas environnementalistes et je me suis rendue compte que ces grands-parents, tout en étant un vecteur de la dégradation de l’environnement, ils étaient aussi des victimes, ils étaient d’une certaine manière exploités par le système extractiviste. Cette situation m’a transmis une notion de justice. On en revient à ce que je disais au début de l’interview : le meilleur levier, c’est de démontrer qu’en ne changeant pas, on devient les victimes de ses propres comportements.
F.L. : Pouvez-vous me dire laquelle des 4 phrases suivantes sur la nature vous inspire le plus ?
“La nature est éternellement jeune, belle et généreuse. Elle possède le secret du bonheur, et nul n'a su le lui ravir. ” Georges Sand
“La nature est un professeur universel et sûr pour celui qui l'observe.” Carlo Goldoni
“C'est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas.” Victor Hugo
“L'Homme a dû combattre la nature pour survivre. Dans ce siècle, il commence à comprendre que pour survivre, il doit la protéger.” Charles III
C.B. : La 1ère, non, il y a un côté trop contemplatif. La 3ème est celle qui me paraît la plus proche de cette représentation de la voix de la nature mais elle est assez négative donc par élimination, je prendrais la 2ème et c’est vrai que la nature est un bon professeur.
C’est donc avec cette belle citation que je clôture l’interview d’une femme passionnée et passionnante ; Goldoni a également écrit que « Le monde est un beau livre mais il sert peu à qui ne sait le lire » ; Corinne Boulangier aide les organisations à mieux lire le monde qui les entoure et à être impactant, avec une grande bienveillance et sans culpabilité, c’est aussi ça la réussite du CARE.
Après la lecture de cet article, vous aimeriez explorer comment intégrer une entité naturelle dans la stratégie de votre entreprise ? Contactez-nous pour avancer, pas à pas, avec Corinne et La SMALA.
Want to print your doc?
This is not the way.
This is not the way.
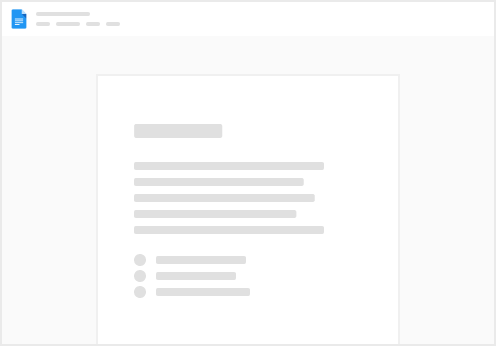
Try clicking the ··· in the right corner or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.